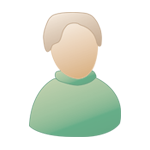C'est fait, le Jules Verne vient de toucher au but. Le cargo européen, lancé par Ariane, depuis l’astroport de Kourou le 9 mars dernier, s'est amarré à la station spatiale internationale (ISS) cet après-midi. Grosse émotion et joie au Centre de contrôle de l'ATV - Automated transfer vehicule, le nom générique du cargo - à Toulouse, d'où les astronavigateurs du Cnes pilotent le vaisseau spatial. L'ISS se trouvait alors à 340 km d'altitude, au dessus de la Méditerranée.
C'est fait, le Jules Verne vient de toucher au but. Le cargo européen, lancé par Ariane, depuis l’astroport de Kourou le 9 mars dernier, s'est amarré à la station spatiale internationale (ISS) cet après-midi. Grosse émotion et joie au Centre de contrôle de l'ATV - Automated transfer vehicule, le nom générique du cargo - à Toulouse, d'où les astronavigateurs du Cnes pilotent le vaisseau spatial. L'ISS se trouvait alors à 340 km d'altitude, au dessus de la Méditerranée.Premier exemplaire d’une série de cinq nefs il constitue le paiement «en nature» de la contribution de l’Agence spatiale européenne (ESA) aux frais de fonctionnement de l’ISS. Il peut apporter près de dix tonnes de fret, carburant, eau, vivres, équipements. Durant les six mois où il demeure attaché, il peut également remonter l'orbite de la station.
Ce succès technique, avec l'amarrage du laboratoire Columbus en février dernier, permet à l'Europe et l'ESA de jouer un rôle important dans la station spatiale. Cette dernière mérite maintenant son qualificatif d'internationale puisque des centres de contrôle répartis aux Etats-Unis, Russie, Europe et Japon (dont le laboratoire Kibo est en partie arrivé là-haut) coopèrent désormais à sa gestion quotidienne.
L’amarrage final du Jules Verne fut la conclusion d’une longue série d’opérations réalisées depuis le tir, destinées à démontrer que le cargo n'allait pas mettre en péril la sécurité de l’équipage de la station. Mais également d’un long et coûteux (1,3 milliard d’euros) programme industriel décidé en 1995.
 Jusqu’à cet après-midi, les astronavigateurs du Cnes, l’Agence spatiale française, qui pilotent le Jules Verne depuis le centre de contrôle de Toulouse, n’avaient d'ailleurs que des motifs de satisfaction. Le vaisseau, un prototype qui ne pouvait pas être testé en vol, obéit au doigt et à l’oeil des ingénieurs comme de ses programmes informatiques. Lors de la première démonstration de sécurité, samedi 29 mars, il devait s’approcher de la station jusqu’à 3,5 km avant d’exécuter une manœuvre d’évitement. Le pilote automatique a conduit le vaisseau qui file à 28.000 km/h et près de 400 km d’altitude, à… 3,501 km de l’ISS. Lundi 31, le cargo s’est approché encore plus près, à 11 mètres seulement du module russe Zvezda où il doit s’amarrer. Un graphique explique le détail de ces manoeuvres. Tout s’est déroulé à la perfection, préparant un succès total cet après-midi. Ci-dessous les photos prises par la caméra de la station lors de ces exercices.
Jusqu’à cet après-midi, les astronavigateurs du Cnes, l’Agence spatiale française, qui pilotent le Jules Verne depuis le centre de contrôle de Toulouse, n’avaient d'ailleurs que des motifs de satisfaction. Le vaisseau, un prototype qui ne pouvait pas être testé en vol, obéit au doigt et à l’oeil des ingénieurs comme de ses programmes informatiques. Lors de la première démonstration de sécurité, samedi 29 mars, il devait s’approcher de la station jusqu’à 3,5 km avant d’exécuter une manœuvre d’évitement. Le pilote automatique a conduit le vaisseau qui file à 28.000 km/h et près de 400 km d’altitude, à… 3,501 km de l’ISS. Lundi 31, le cargo s’est approché encore plus près, à 11 mètres seulement du module russe Zvezda où il doit s’amarrer. Un graphique explique le détail de ces manoeuvres. Tout s’est déroulé à la perfection, préparant un succès total cet après-midi. Ci-dessous les photos prises par la caméra de la station lors de ces exercices.
La réussite des ingénieurs européens, du Cnes et d’Astrium, le fabricant du Jules Verne, contribue à donner une dimension véritablement internationale à l’ISS alors qu’elle était surtout américano-russe. Les laboratoires européen - Columbus - et japonais - Kibo -, arrivés en février et mars augmentent considérablement sa «surface utile». Et donnent l’espoir aux Agences spatiales de terminer son assemblage d’ici 2010, date de la mise à la retraite des navettes. Ici, la visite guidée de la station par Jean-François Clervoy, astronaute.
Paradoxe : ce succès relance le débat sur l’avenir de la station. Les accords entre Agences prévoient sa maintenance jusqu’en 2015. Mais faudra t-il alors la bazarder, en la laissant retomber dans l’atmosphère ?
 Ce serait un joli gâchis, argumentent les européens et les japonais qui espèrent exploiter leurs labos plus longtemps, même si le doute a grandit sur le potentiel scientifique de ces recherches en microgravité.
Ce serait un joli gâchis, argumentent les européens et les japonais qui espèrent exploiter leurs labos plus longtemps, même si le doute a grandit sur le potentiel scientifique de ces recherches en microgravité.Mais la Nasa doit réaliser le programme «Bushien» de retour sur la Lune décidé pour des raisons plus politiques que scientifiques : démontrer au monde, comme à l’époque d’Apollo, que les Etats-Unis sont toujours le «leader» du monde. Un choix lourd qui suppose de développer deux nouvelles fusées - Ares-I et Ares-V-, le vaisseau Orion et l’engin lunaire Altaïr. Puis de s’élancer vers l’astre de la nuit pour y poser des astronautes dès 2020. Est-ce financièrement compatible avec le maintien des opérations sur l’ISS ? Si le budget de la Nasa, environ 15 milliards de dollars par an, reste en l’état, cela semble peu réaliste. Et rien ne laisse supposer que les Etats-Unis veuillent augmenter encore leur budget spatial, déjà bien supérieur à celui de l’Europe.
Faudra t-il lâcher la proie - l’ISS - pour l’ombre - une éventuelle participation à cette aventure lunaire, aux conditions dictées par les Etats-Unis? Avec des coûts et des délais largement inconnus... Jean-Jacques Dordain, le directeur général de l’ESA, faisait remarquer, à Kourou lors du tir du Jules Verne, qu’une installation lunaire «ne bénéficierait pas de l’absence de gravité… la principale caractéristique de la station orbitale». Les deux sites ne sont donc pas équivalents, tant pour la science que pour la préparation de vols plus lointains, vers Mars. Surtout, il préconisait aux gouvernements européens de ne pas sacrifier l'utile - la surveillance de la Terre, du climat, les missions scientifiques - aux vols habités. Comme les technologies spatiales supposent de longues durées de développement. Les décisions qui dessineront les grandes lignes des activités des années 2020, du moins pour les vols habités, seront prises d’ici 2010. Des révisions déchirantes sont donc au programme… et d’intenses discussions entre partenaires.